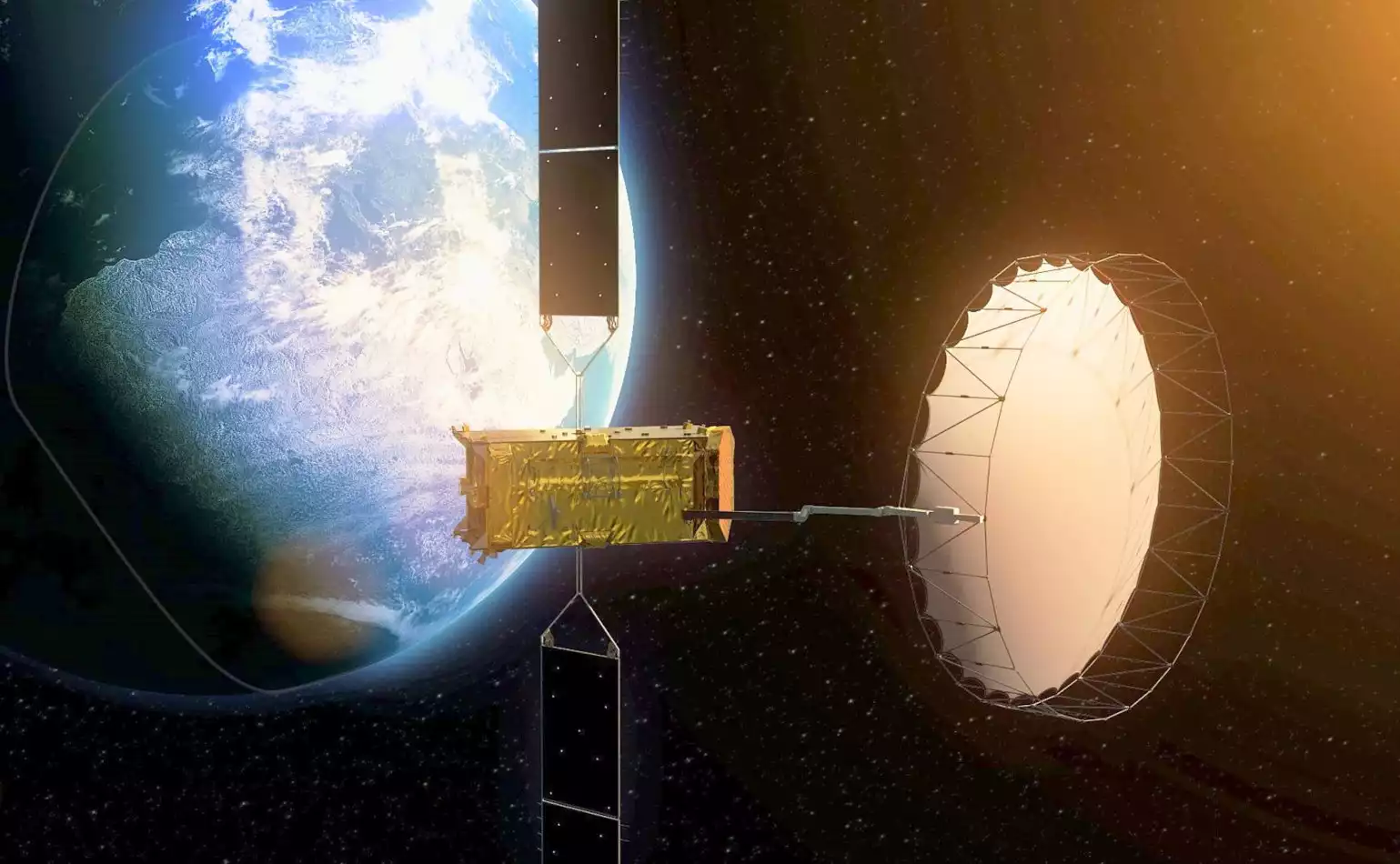
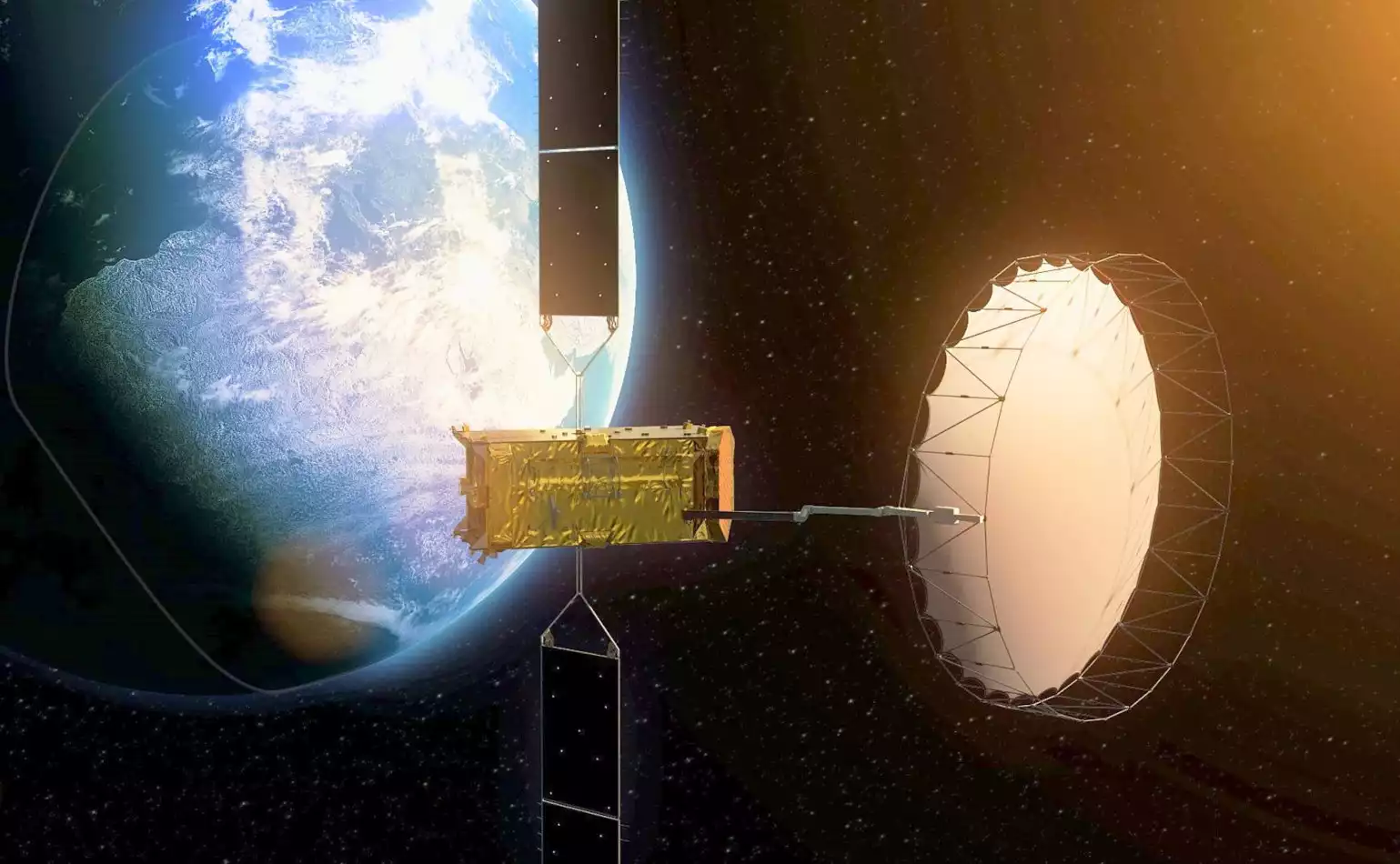
Didier Faivre, ancien directeur du Centre Spatial Guyanais et ex-directeur de Galileo à l’ESA, et Bertrand de Montluc, ancien directeur des affaires internationales du CNES, estiment que les évolutions nécessaires de la règle du « retour », très critiquée aujourd’hui, doivent préserver « l’aller » : les financements publics nationaux mutualisés au sein de l’ESA, source principale de financement du secteur spatial, et garantie du maintien de l’autonomie de l’Europe.
La règle du retour géographique telle qu’appliquée par l’Agence spatiale européenne depuis sa création fait l’objet de nombreuses critiques venues de milieux industriels et institutionnels. Si les défauts et dérives ne peuvent être négligés, cette règle a permis, tout en préservant les intérêts industriels et financiers des Etats – aujourd’hui encore principale source de financement du secteur spatial – de créer un programme européen de premier rang et de maintenir une industrie européenne à la fois compétitive sur les marchés mondiaux et capable de développer et opérer les infrastructures spatiales répondant aux besoins publics de façon autonome et avec un niveau de performance et de qualité comparable aux meilleures productions mondiales, et cela malgré un niveau de financement très inférieur à celui des autres puissances mondiales. La règle du retour est basée avant tout sur le principe d’une préférence européenne et nationale financée librement par les Etats dont les ambitions et les capacités industrielles sont très différentes : ses qualités (sécuriser « l’aller » c’est à dire le financement) comme ses défauts en sont la conséquence. Avec la montée en puissance du secteur privé et l’évolution du paysage institutionnel en Europe la question du maintien de cette règle se pose et des évolutions sont possibles sans nuire au secteur spatial européen unanimement reconnu comme un succès de la construction européenne, et sans mettre en danger l’indépendance de l’Europe dans ce secteur stratégique qui repose sur une industrie de haute technologie qui dépend largement de la commande publique en particulier pour les programmes de l’ESA.
Un discours très critique sur l’organisation spatiale européenne est devenu récurrent dans certains cercles institutionnels et industriels, abondamment relayé par la presse économique spécialisée : l’organisation institutionnelle de l’Europe spatiale, qualifiée de « mille-feuille », et le manque de compétitivité de l’industrie seraient liés en particulier à l’application de la règle du retour géographique appliquée par l’Agence spatiale européenne (ESA). En réalité, après analyse, les critiques du retour industriel proviennent essentiellement du maître d’œuvre des lanceurs largement dépendant du financement public pour le développement et l’exploitation des services de lancement, lequel souhaite simplifier son organisation industrielle de production ; de la France aussi qui protège son leadership industriel (près de 40 % de l’emploi européen est en France) tout en partageant le fardeau budgétaire ; et plus récemment de la Commission européenne fidèle à sa doctrine de compétition libre et non faussée. Une revue des points de vue, réalistes, critiques ou louangeurs à ce sujet clé de la programmation spatiale en Europe est devenue nous semble-t-il indispensable.
Dans la passation des contrats industriels, l’ESA applique une politique de préférence européenne définie explicitement dans sa Convention fondatrice : « Dans la passation de tous les contrats, l’Agence donne la préférence à l’industrie et aux organisations des États membres. Cependant, à l’intérieur de chaque programme facultatif, une préférence particulière est donnée à l’industrie et aux organisations des États participants ». Les programmes spatiaux européens sont de fait développés, produits et opérés par des fournisseurs européens. L’ESA, et c’est à notre sens son mérite, n’attribue qu’exceptionnellement des contrats à des fournisseurs non-européens. Les programmes nationaux suivent d’ailleurs cette pratique de préférence nationale et européenne, à l’exception notable de certains services de lancement. L’autonomie ne nuit nullement à la qualité ou à la performance. Dans tous les domaines des applications spatiales (science, observation, météorologie, télécommunications, navigation, lanceurs et dans une moindre mesure applications militaires encore peu développées au niveau européen), l’Europe dispose de fait d’une base industrielle et technologique qui peut fournir l’ensemble des infrastructures et des services requis avec un niveau de performance et de qualité comparable aux meilleures productions mondiales. Exception notable : certaines activités spécifiques du vol habité (véhicules de transport, activités extravéhiculaires) auxquelles l’Europe a renoncé au début des années 90, sans que cela nuise à la qualité globale ou à l’image du spatial européen (impact mondial des programmes scientifiques Planck, Rosetta, ou des programmes d’application (Galileo, Copernicus). L’industrie européenne a par ailleurs démontré sa compétitivité dans le domaine strictement commercial. Les industriels sont très présents sur le marché mondial des satellites (observation et télécommunications) et des services de lancement et y rencontrent des succès auprès d’opérateurs privés internationaux. Malgré un volume d’activité et de financement public très inférieur à celui des autres puissances (Etats-Unis, Chine et Russie), lesquelles n’attribuent leurs financements publics qu’à leur industrie nationale (« Buy American Act » par exemple), la pratique du retour industriel ESA n’affecte donc ni l’autonomie européenne, ni la qualité des programmes ni la compétitivité. Tout indique au contraire que le cadre institutionnel européen « protecteur », principale source de financement du secteur spatial pour la R&T et les développements, et maître d’ouvrage de grands programmes a de fait contribué à la création et au maintien d’une industrie européenne de premier rang. La continuité des programmes et des financements de l’ESA a aussi permis une politique de spécialisation en Europe au-delà des « grands contributeurs » France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni : panneaux solaires aux Pays-Bas, calculateurs de bord et divergents pour la Suède, systèmes électriques et composants mécaniques pour la Belgique, horloges atomiques et coiffes pour la Suisse, opérations et mécanique spatiale en Espagne, etc., qui permet de satisfaire les besoins européens.
On peut aussi observer que progressivement l’application de la règle de retour s’est durcie. On est passé d’un coefficient de retour global garanti (calculé comme le rapport entre le pourcentage de l’ensemble des contrats reçus dans un Etat participant et le pourcentage des financements de ce pays à l’agence spatiale européenne) de 0,8 à plus de 0,95 ou parfois même de 1 pour certains programmes, assorti de mécanismes complexes de compensations. Equation devenue ingérable pour le responsable de programme avec en particulier l’accroissement du nombre d’Etats-membres, avec des niveaux de financement modestes et une industrie émergente, conduisant dans certains cas à un émiettement de l’organisation industrielle et une dilution des tâches de maîtrise d’œuvre. On ne connaît toutefois pas de programme institutionnel qui ait connu un échec technique en raison de l’application du retour géographique. Avec la montée en puissance du secteur privé initiée aux Etats-Unis (pas en Chine ou en Russie pour le moment), se pose tout de même la question de l’efficacité économique des industriels européens : l’industrie européenne propose-t-elle des objets de bonne qualité mais trop chers, ou plus chers que la concurrence ? Il faudrait pour être précis distinguer d’une part les programmes dits institutionnels pour lesquels les Etats européens mutualisent leurs compétences et leurs financements (les infrastructures que les Etats européens « achètent ») et d’autre part les programmes financés ou soutenus par les Etats mais destinés à la compétition sur un marché mondial (les programmes que l’Europe « vend » à des tiers) peu ou pas soumis à des considérations politiques.
Dans le premier cas (typiquement une mission scientifique, d'exploration, de météorologie), même s’il est admis que le coût d’un programme en coopération augmente en fonction du nombre de partenaires, chacun des partenaires ne paye que sa part, tout en bénéficiant de tous les résultats et services du programme, du prestige d’avoir participé à un programme d’envergure mondiale, et cela avec la certitude que leurs financements alimentent leur industrie nationale. Dans ce cas, la coopération s’impose, elle permet à tous les participants d’accéder à un programme dont l’ambition et le coût sont inaccessibles au niveau national. Pour le programme scientifique de l’Agence spatiale européenne, l’application de la règle du retour pour tous les Etats-membre mais selon la répartition des PIB (tous les Etats membres participent de façon obligatoire selon leur richesse nationale), est certainement l’une des clés de la création du programme et de sa pérennité et du soutien sans faille de tous les Etats-membres. Les missions sont sélectionnées par les scientifiques des différentes disciplines et réalisées par l’industrie européenne sous la responsabilité des équipes techniques de l’Agence spatiale européenne sans que l’on puisse attribuer un « drapeau » national aux satellites ou sondes développés ou à l’équipe en charge de la réalisation. Tout cela concourt à la fois à l’excellence et au caractère européen de ce programme salué mondialement. Pour le programme scientifique, comme pour les programmes facultatifs où chaque Etat détermine son niveau de financement, le retour financier vers l’industrie nationale est une motivation importante pour les Etats et l’une des clés du succès de la coopération via l’ESA et de son financement. Malgré la croissance du secteur privé, l’activité spatiale européenne reste largement dominée par la commande institutionnelle. Alors que les budgets communautaires censés ignorer les intérêts nationaux sont en croissance, cette commande publique reste majoritairement portée par l’ESA, agence de statut international, elle-même principalement financée par les budgets nationaux des Etats membres. Les Etats seraient-ils prêts à financer les programmes sans cette garantie de retour ? Toute réforme de la politique industrielle et du « retour » doit donc aussi sécuriser « l’aller » soit le flux contributif entrant, c’est à dire aujourd’hui le financement national des programmes qui maintient une industrie de taille modeste (quelques dizaines de milliers d’employés), détentrice du savoir-faire très spécialisé d’un secteur stratégique très dépendant de la commande publique.
Pour les systèmes, satellites ou services, qui se vendent sur un marché ouvert, c’est le client qui organise une compétition et sélectionne le meilleur concurrent selon un critère de « Best Value for Money ».
- Les satellites de télécommunications appartiennent majoritairement de cette catégorie et, dans une moindre mesure, les systèmes d’observation. Les maîtres d’œuvre qui répondent aux appels d’offre organisent leur structure industrielle pour bâtir la meilleure proposition. Les agences ne contribuent pas directement mais soutiennent l’industrie par le maintien des compétences communes mises en œuvre dans les grands programmes publics de développement et par des activités spécifiques de R&T dont les activités sont concertées avec l’industrie. Ainsi le programme technologique de télécommunications ARTES de l’ESA a pour objectif principal le soutien à la compétitivité de l’industrie.
- Pour les lanceurs, la situation est plus complexe, car il s’agit d’une activité que les Etats « achètent » pour garantir l’accès autonome à l’espace, clé de toute politique spatiale, et aussi une filière de services que l’on souhaite vendre sur le marché commercial à la fois pour l’activité induite, avec l’espoir d’en faire une filière industrielle rentable susceptible de contribuer aux coûts fixes de la filière (maintien des équipes et des usines, suivi de la qualité et de la fiabilité, base de lancement) grâce à une cadence de tirs plus élevée que celle, modeste, requise par les programmes institutionnels. Les Etats financent la R&T amont, l’essentiel des développements, les services de lancement dont ils sont clients - à un prix parfois supérieur à celui du marché (ESA, Défense) – et une part importante des coûts d’exploitation (dont ceux de la base de lancement). Tandis que le volume de l’activité industrielle de lancement est très largement conditionné par les ventes au secteur privé, le financement de la filière reste dépendant du secteur public en raison du poids des programmes de développement et des soutiens à l’exploitation.
Sur le marché commercial, après des années très favorables (où le concurrent principal était Proton depuis Baïkonour, les Américains étant peu présents après leurs déboires sur le Space Shuttle), l’opérateur européen se trouve aujourd’hui confronté au retour d’une concurrence américaine revigorée par de jeunes acteurs du secteur privé – largement soutenue par les clients institutionnels américains – qui démontre fiabilité, cadence de lancement et prix attractifs depuis des centres de lancement situés aux Etats-Unis à une demi-journée de vol des usines de satellites ! Le centre de lancement de Kourou qui était un atout face à Baïkonour ne l’est plus pour les opérateurs internationaux et les industriels américains. Avec la Floride, le Texas ou la Californie : « You fly domestic and you speak English. » En Europe, si l’accès autonome à l’espace reste une priorité absolue de toute politique spatiale indépendante, le faible nombre de lancements institutionnels annuels et la compétitivité accrue des lanceurs américains (soutenus par une commande publique sans commune mesure avec la commande publique européenne) pose de façon aiguë la question du soutien public à une exploitation commerciale. Cette question va en réalité bien au-delà de l’application ou non du « juste retour ».
Il est certain que l’application de la règle du retour géographique par Etat participant dans les programmes de l’ESA introduit des biais dans l’attribution des contrats., mais on ne peut attribuer à cette règle les difficultés ou les retards rencontrés par certains programmes. Le principal défaut de cette pratique liée à la conjoncture de naissance de l’ESA tient à la structure industrielle imposée par le système coopératif de l’ESA et de ses 22 Etats-membres qui tous souhaitent une place dans les grandes initiatives prestigieuses. Cela conduit à une abondance de contractants et à un éparpillement géographique de la production (usines, moyens d’essais, segment sol) pour satisfaire tous les participants avec parfois des niveaux de participation très faibles qui alourdissent la gestion par le maître d’œuvre, lui-même dilué et affaibli dans ses tâches de pilotage du programme. De plus, au-delà de la phase de développement, les Etats ne manifestent pas un grand enthousiasme à financer l’exploitation et en particulier la base de lancement pour laquelle aucun retour technologique intéressant ne peut être espéré. Bien que la plupart des sous-traitants soient sélectionnés après compétition, l’application de la règle du retour peut parfois conduire à la non-sélection du « mieux disant » au profit de l’industriel du pays qui n’a pas reçu son « retour ». La mise en œuvre du « juste retour » donne également lieu à des calculs savants et à des débats assez stériles (par exemple, retour par programme ou retour global ? retour financier ou retour technologique ? retour garanti à 80 % ou 95 % ?) qui constituent des obstacles au démarrage des programmes quand le consensus entre Etats participants est requis. Pour certains grands programmes facultatifs, la garantie du retour conduit les Etats à conditionner leur financement à la garantie a priori de voir leurs champions nationaux obtenir tel ou tel lot de travaux, ou à soutenir la création de consortiums artificiels et inefficaces rassemblant tous les maîtres d’œuvre potentiels qui se partagent les tâches et les financements en interdisant de fait toute compétition. Au final, l’application stricte du retour industriel a conduit dans certains programmes à des choix sous-optimaux en termes de compétitivité et pu handicaper les perspectives commerciales quand le produit développé se doit d’attirer des clients internationaux qui ne se soucient pas de la nationalité du fournisseur.
L’ESA a su mettre en œuvre, au début des années 2000 une approche qui peut réconcilier les avantages de l’efficacité industrielle et la garantie de retour aux Etats qui financent … et même un peu plus en cas de succès commercial. Il s’agit de transformer l’application du « juste retour » - qui contraint l’Exécutif à attribuer les contrats en fonction du niveau de contribution des Etats – et de mettre en œuvre un principe de « juste contribution » - qui consiste à inviter les Etats à financer les programmes en fonction de la répartition des contrats résultant de compétitions industrielles organisées par les maîtres d’œuvre et l’ESA. Cette méthode a été appliquée pour le programme de télécommunication Alphabus de développement d’une nouvelle plateforme de satellite géostationnaire de grande puissance destinée au marché mondial. Le maître d’œuvre (en l’occurrence les grands industriels français présents sur le marché des télécommunications et décidés à allier leurs forces sur le marché des « grandes plates-formes »), a proposé à l’ESA l’européanisation de son initiative sous réserve du respect des objectifs commerciaux. L’ESA qui n’a pas vocation à acheter de telles plates-formes de grande puissance pour ses besoins propres a proposé ce programme à ses Etats-membres, avec des règles adaptées à la nature du projet : la phase de définition (phase A et B) est menée par le maître d'œuvre dans une structure industrielle très resserrée avec une participation financière limitée aux Etats dont le maître d'œuvre est ressortissant. Pour Alphabus, le programme avait été engagé par le CNES sur fonds nationaux français et transféré à l’ESA, la France finançant cette phase de définition. Le plan d’approvisionnement pour les phases ultérieures (développement et production) est défini conjointement avec l’ESA qui organise les compétitions intra-européennes, La sélection des sous-traitants est arrêtée par le maître d'œuvre sur la base de la meilleure offre compétitive. L’ESA adresse alors aux Etats-membres le taux de contribution qui correspond au niveau de contrats obtenu par les industriels nationaux. L’adéquation entre financement national et activités industrielles est donc garanti, mais a posteriori. Le point clé pour obtenir l’adhésion des Etats tient au fait que le maître d’œuvre s’engage auprès de son fournisseur, au-delà du premier modèle financé par l’ESA, à inclure le sous-traitant retenu dans la production de la série qui sera proposée sur le marché commercial (où l’ESA n’intervient plus). En cas de succès commercial, l’activité de production financée par le client permet d’obtenir un retour d’activité supérieur à l’investissement initial consenti par l’Etat participant pour le développement. C’est un « sur-retour » qui est garanti en cas de succès. Cette approche a rencontré une certaine de la part de l’Exécutif de l’ESA qui voyait par là son pouvoir réduit dans la définition et le montage industriel du produit et qui craignait de perdre le soutien et le budget de ceux qui ne seront pas retenus. Certains Etats qui avaient l’habitude de peser pour satisfaire telle ou telle compagnie en fonction de telle ou telle priorité politique ont également contesté cette approche. Toutefois, la méthode a réussi et tous les sous-traitants (sauf un) ont été retenus sur la base de la meilleure offre. L’ESA a adressé aux Etats la « facture » correspondant aux compétitions gagnées par leur industrie, facture qui a été acceptée par tous.
Le succès de cette forme différente d’approvisionnement tient à plusieurs conditions essentielles :
- la crédibilité du maître d'œuvre et du produit qui offre une perspective de production en série,
- la confiance en l’Exécutif ESA qui doit s’assurer que les industriels des « petits pays » seront bien traités,
- le soutien du pays leader qui devra financer une part importante : les phases de définition,
- la part propre du maître d'œuvre, et les équipements gagnés par l’industrie nationale
- l’existence d’un programme « réservoir » flexible comme ARTES qui permet aux Etats d’adapter leurs contributions à l’intérieur d’un même cadre financier pluriannuel en fonction des compétitions gagnées sans perdre les fonds non utilisés qui peuvent être alloués à d’autres initiatives.
Ce programme de R&T ARTES essentiellement dédié au soutien à la compétitivité exige également un co-financement des industriels et reçoit un bon soutien de l’industrie et des Etats. Bien entendu la procédure ne fonctionne que si les sous-traitants retenus sont eux-mêmes compétitifs et s’il est possible d’organiser de vraies compétitions entre équipementiers, sans choix dictés par des considérations politiques des Etats ou du maître d'œuvre. Si l’éparpillement est un risque, le monopole en est un également. Il est fondamental que l’Europe spatiale dans la conjoncture actuelle dispose dans un certain nombre de secteurs de plusieurs sources en compétition susceptibles d’être retenues pour les programmes institutionnels ou commerciaux.
Une autre solution souvent citée viserait à adopter un financement européen communautaire sans contributions nationales identifiées. Pour la France, cette approche permettrait d’espérer un retour « naturel » conforme au poids de l’industrie française en Europe (environ 35 % à 40 %), soit près de deux fois le poids de l’Allemagne en ne finançant qu’au niveau du PNB (environ 17 %). Pour que cela fonctionne, il faut bien sûr que les autres pays dont les dépenses publiques et les capacités industrielles sont très inférieures à celles de la France adhèrent, au niveau européen, à l’ambition spatiale portée principalement par la France et acceptent de soutenir à leurs frais le maintien du leadership industriel français ! En l’absence d'une garantie de retour, le système de financement des programmes facultatifs de l'ESA où chaque pays détermine librement son niveau de participation aux programmes ne pourrait être maintenu, ce serait donc à une structure communautaire de prendre le relai.
Sans entrer en détail dans les questions d’organisation et de gouvernance européennes de type UE cette approche soulève plusieurs questions :
- Inscrire les activités spatiales dans un cadre programmatique UE, piloté par la Commission avec un budget spatial commun et des sélections des fournisseurs sur la base d’une compétition ouverte et non biaisée permettrait-il de s’affranchir des défauts du retour tout en conservant le niveau budgétaire de l’Europe ?
- Comment pallier la faiblesse de compétences techniques internes, ou d’autonomie, des différentes structures mises en place par la Commission (pour Galileo GJU, GSA, ou nouvelle agence communautaire EUSPA), sans dupliquer les compétences existantes et réduire le mille-feuille institutionnel décrié (agences nationales, ESA, agences de l’Union, Commission) ?
- Les Etats sont-ils prêts à intégrer les compétences propres de l’ESA sous leur autorité dans une structure pilotée par la Commission ?
- Est-il opportun que l’Europe s’ampute, comme elle l’a fait sur Galileo, des compétences industrielles de premier rang (et du financement) britanniques ?
Du côté de la Commission, le désir d’appuyer d’un poids croissant le secteur spatial alliant prestige politique, dimension stratégique, haute technologie et pilotage de l’industrie est louable ; mais moins évident quand il s’agit de contribuer à des activités moins nobles. Par exemple, le financement de Kourou « Port spatial de l’Europe » reste à ce jour purement intergouvernemental, inscrit parmi les activités obligatoires de l’ESA, et largement supporté par la France. La base est indispensable à l’Europe, mais son intérêt technologique est médiocre pour un coût important. Les Etats sont très réticents à financer une part même modeste des tâches d’exploitation sans synergies significatives avec l’activité européenne et largement consacrées à des dépenses de personnel local. L’attribution de contrats de maintenance à des entreprises européennes n’élimine pas frustrations et critiques localement et en Europe. La recherche du retour atteint ses limites. Dans le cadre de l’UE, autre question, le retour ne disparait pas aussi simplement : ainsi les programmes de R&T communautaires exigent le montage de consortium parfois artificiels où les critères politiques n’ont pas totalement disparu. L’expérience de Galileo, menée en principe sans contrainte de retour, a montré que la Commission elle-même a mis en place pour obtenir un accord politique des mesures contraires à la « compétition libre et non faussée ». Il a d’abord été décidé de confier le développement de l’infrastructure Galileo à une compagnie créée spécifiquement, en réalité une coopération entre concurrents plus intéressés par l’équilibre des financements et des pouvoirs au sein du consortium qu’à la bonne marche du programme (ESNIS ou Galileo Industries). Même après l’élimination de cette structure artificielle, la Commission a dû, sous la pression des Etats, structurer le projet en sous-ensembles taillés pour satisfaire les positions des champion nationaux : ainsi en raison de règles de non-cumul, le segment spatial ne pouvait échapper à l’Allemagne alors qu’une concurrence aurait été possible avec Britanniques, Italiens et Français. Le segment sol a lui aussi été réparti entre les pays avec une abondance d’infrastructures loin de l’optimum économique. La compétition pour définir l’opérateur de Galileo a fini par le choix d’un consortium fusionné, qui a disparu avec l’abandon du PPP. Si la Commission a pour rassurer les « petits » demandé aux maîtres d'œuvre de garantir un pourcentage de retour aux sous-traitants, elle n’a en fait jamais pu contrôler ce critère.
Alors que l’ESA, édicte dans sa Convention une règle générale de préférence européenne, la Commission n’a pas vraiment de politique générale de ce type pour ses achats. Elle avait même souhaité ouvrir, pour Galileo, certaines compétitions à des fournisseurs hors UE (et même hors Europe), pour des éléments techniques clés. Dès lors, la question de l’achat des services de lancement « standards » pour des programmes « civils » auprès d’opérateurs exclusivement européens se pose. Contrairement aux agences fédérales américaines, la Commission ne semble pas prête à acheter des lancements à un prix correspondant au coût « réel » c’est à dire supérieur au prix de marché afin de soutenir la filière d’indépendance. Les Etats, habitués à s’approvisionner pour leurs besoins de défense aux Etats-Unis, verraient-ils vraiment des objections à acheter des lancements non-européens moins chers qu’Ariane ou Vega, surtout si ces lanceurs européens restent pour certains un lanceur « français » ou un lanceur « italien ».
En conclusion, dans un paysage dominé dans les faits par la commande publique financée par les budgets nationaux, l’Europe a forgé une capacité industrielle autonome et de qualité capable de développer, produire opérer toutes les infrastructures spatiales – il s’agit là au moins d’un point d’accord entre agences et industriels.
L’application du « juste retour » a contribué jusqu’à maintenant à l’émergence d’une structure industrielle y compris dans les « petits pays », source de fierté nationale et de financement. En revanche, cela a conduit avec l’accroissement du nombre de pays membres, à un émiettement des participations aux programmes nuisible au pilotage industriel, à des choix ne favorisant pas la compétitivité et également à des duplications d’infrastructures (y compris dans les grands pays qui ne sont pas prêts à renoncer à certaines installations).
Des aménagements du système actuel semblent possibles :
- pour éviter le trop grand nombre de participants par programme, en appliquant plus rigoureusement la règle de la participation minimale pour les programmes ESA
- pour éviter les duplications excessives, en soutenant une politique de spécialisation permettant l’émergence de quelques champions européens,
- pour favoriser la compétitivité de l’industrie, en favorisant autant que possible les compétitions intra-européennes et pour les programmes destinés à un marché ouvert privé en appliquant le principe de la « juste contribution » pour les développements financés par le secteur public,
- en assouplissement l’application comptable de la règle (retour global, retour à un taux garanti de 80 %),
- en imposant autant que possible pour les programmes destinés au marché commercial ouvert des règles de co-financement, garantie en quelque sorte d’engagement réel de l’industrie et aussi marque de confiance dans un retour sur investissement hors commandes publiques.
Pour aller plus loin et s’affranchir des contraintes du retour industriel, l’Europe pourrait privilégier l’achat de services offerts par l’industrie européenne et développés sur fonds privés. Le domaine des lanceurs semble adapté à cette approche (existence d’un marché privé et public) pour des services largement standardisés de nos jours. L’industrie européenne des lanceurs souhaite s’affranchir des contraintes du retour, elle ne s’en cache pas et cherche une forme de dialogue avec les agences gouvernementales nationales et européennes. Mais est-elle en mesure de prendre pleinement en charge les risques inhérents et faire l’impasse sur les financements publics des développements et cela tout en revendiquant un renforcement de nouveaux programmes publics captifs (le vol habité) ?
On en revient par conséquent à la question initiale du financement des activités spatiales dans une Europe qui ne va pas cesser de s’élargir tandis que les nations sont de plus en plus jalouses de leur intérêt national industriel, avec des contraintes financières/budgétaires corrélées au retour industriel, le tout dans un cadre encore largement national (Chine, US, Russie).
Dans le cas particulier de l’Europe – qui n’est ni une assemblée lâche d’Etats nationaux ni une fédération armée pour faire face à toutes sortes de menaces régaliennes, scientifiques et commerciales – le défi appelle à des évolutions vertueuses. Si remplacer le financement intergouvernemental par un financement communautaire « sans couleurs nationales » est aujourd’hui selon certains supposé nous affranchir des contraintes liées au retour, cela suppose à budgets publics constants une augmentation substantielle (facteur 3 ou 4) des budgets publics communautaires alloués au spatial, et donc d’une part une acceptation politique des Etats de l’Union qui perdraient la garantie de retour et d’autre part la mise en place d’une réelle expertise technique et de capacité d’achat de systèmes spatiaux au sein des institutions de l’UE. La réflexion actuelle des acteurs étatiques, industriels et académiques de la filière spatiale sur les mérites et limites des principes inscrits dans la Convention de l’ESA au sujet de la politique industrielle, dans un domaine désormais en bonne partie européanisé, n’est pas sans mérite : ne serait-ce que du fait qu’à l’évidence les recettes du passé ne sont plus valables dans un environnement des activités spatiales institutionnelles et commerciales en évolution rapide à l’échelle internationale et avec l’émergence d’acteurs nouveaux aux côtés des agences spatiales. Le retour industriel géographique ne pose à ce jour, faut-il le rappeler, de problème majeur ni pour la science, ni pour l’exploration, ni pour la météorologie, ni pour l’observation de la Terre, ni pour les télécommunications. Il peut conduire à des désoptimisations économiques, en particulier pour les produits et services développés dans le cadre ESA et appelés à se développer dans un cadre commercial. Des mesures d’assouplissement ou une évolution vers une « juste contribution » semblent pouvoir atténuer les défauts les plus criants. Enfin la règle du retour est basée avant tout sur le principe d’une préférence européenne financée librement par les Etats : ses qualités (sécuriser « l’aller » c’est à dire le financement) comme ses défauts (ici évoqués) en sont la conséquence. Dès lors, la contradiction avec les règles européennes de compétition et de soutien public doit être tranchée par les Etats, sans nuire aux succès et au maintien du secteur spatial européen unanimement reconnu comme un succès de la construction européenne.
Didier Faivre, ancien directeur du Centre Spatial Guyanais et ex-directeur de Galileo à l’ESA, et Bertrand de Montluc, ancien directeur des affaires internationales du CNES, estiment que les évolutions nécessaires de la règle du « retour », très critiquée aujourd’hui, doivent préserver « l’aller » : les financements publics nationaux mutualisés au sein de l’ESA, source principale de financement du secteur spatial, et garantie du maintien de l’autonomie de l’Europe.
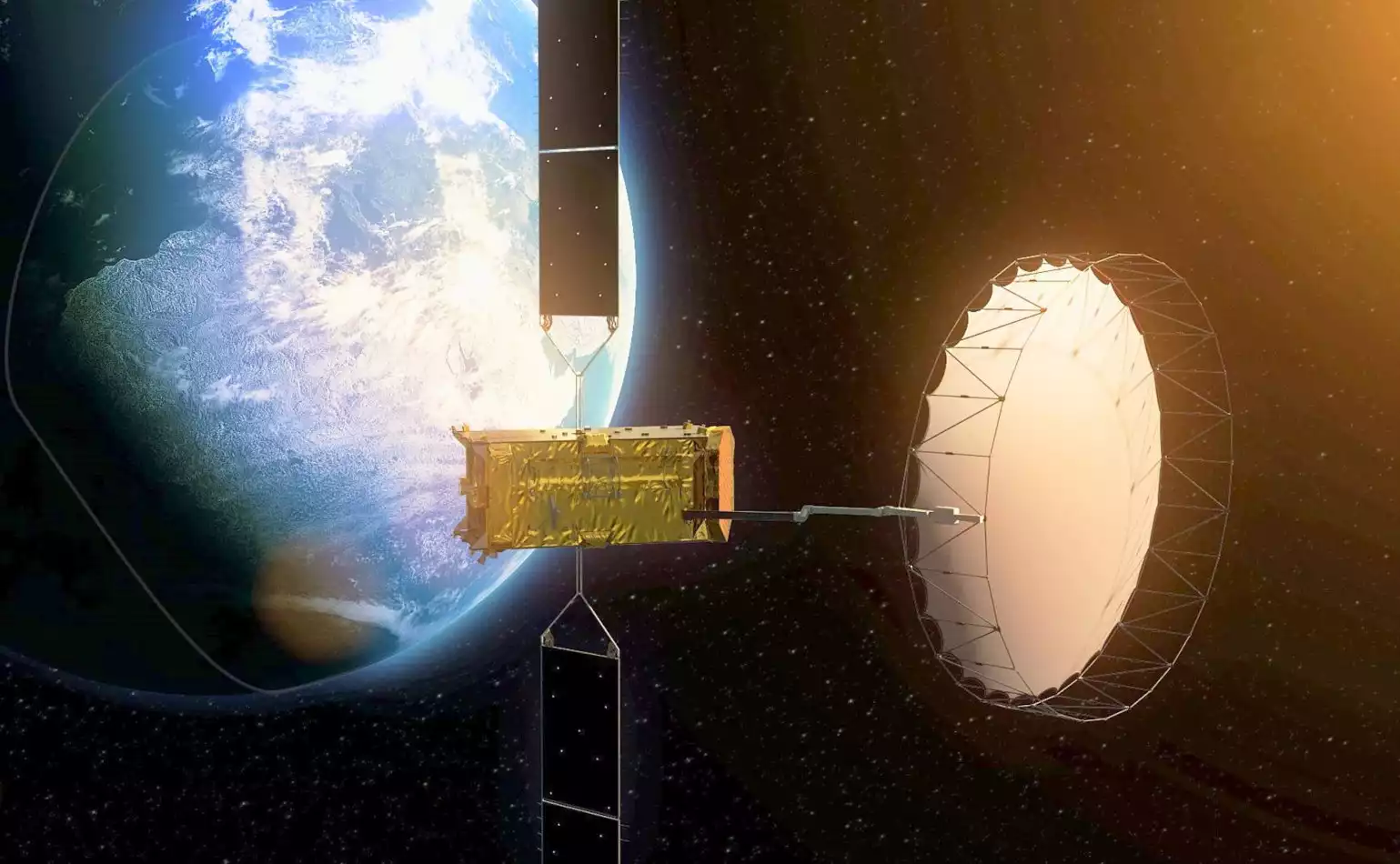
La règle du retour géographique telle qu’appliquée par l’Agence spatiale européenne depuis sa création fait l’objet de nombreuses critiques venues de milieux industriels et institutionnels. Si les défauts et dérives ne peuvent être négligés, cette règle a permis, tout en préservant les intérêts industriels et financiers des Etats – aujourd’hui encore principale source de financement du secteur spatial – de créer un programme européen de premier rang et de maintenir une industrie européenne à la fois compétitive sur les marchés mondiaux et capable de développer et opérer les infrastructures spatiales répondant aux besoins publics de façon autonome et avec un niveau de performance et de qualité comparable aux meilleures productions mondiales, et cela malgré un niveau de financement très inférieur à celui des autres puissances mondiales. La règle du retour est basée avant tout sur le principe d’une préférence européenne et nationale financée librement par les Etats dont les ambitions et les capacités industrielles sont très différentes : ses qualités (sécuriser « l’aller » c’est à dire le financement) comme ses défauts en sont la conséquence. Avec la montée en puissance du secteur privé et l’évolution du paysage institutionnel en Europe la question du maintien de cette règle se pose et des évolutions sont possibles sans nuire au secteur spatial européen unanimement reconnu comme un succès de la construction européenne, et sans mettre en danger l’indépendance de l’Europe dans ce secteur stratégique qui repose sur une industrie de haute technologie qui dépend largement de la commande publique en particulier pour les programmes de l’ESA.
Un discours très critique sur l’organisation spatiale européenne est devenu récurrent dans certains cercles institutionnels et industriels, abondamment relayé par la presse économique spécialisée : l’organisation institutionnelle de l’Europe spatiale, qualifiée de « mille-feuille », et le manque de compétitivité de l’industrie seraient liés en particulier à l’application de la règle du retour géographique appliquée par l’Agence spatiale européenne (ESA). En réalité, après analyse, les critiques du retour industriel proviennent essentiellement du maître d’œuvre des lanceurs largement dépendant du financement public pour le développement et l’exploitation des services de lancement, lequel souhaite simplifier son organisation industrielle de production ; de la France aussi qui protège son leadership industriel (près de 40 % de l’emploi européen est en France) tout en partageant le fardeau budgétaire ; et plus récemment de la Commission européenne fidèle à sa doctrine de compétition libre et non faussée. Une revue des points de vue, réalistes, critiques ou louangeurs à ce sujet clé de la programmation spatiale en Europe est devenue nous semble-t-il indispensable.
Dans la passation des contrats industriels, l’ESA applique une politique de préférence européenne définie explicitement dans sa Convention fondatrice : « Dans la passation de tous les contrats, l’Agence donne la préférence à l’industrie et aux organisations des États membres. Cependant, à l’intérieur de chaque programme facultatif, une préférence particulière est donnée à l’industrie et aux organisations des États participants ». Les programmes spatiaux européens sont de fait développés, produits et opérés par des fournisseurs européens. L’ESA, et c’est à notre sens son mérite, n’attribue qu’exceptionnellement des contrats à des fournisseurs non-européens. Les programmes nationaux suivent d’ailleurs cette pratique de préférence nationale et européenne, à l’exception notable de certains services de lancement. L’autonomie ne nuit nullement à la qualité ou à la performance. Dans tous les domaines des applications spatiales (science, observation, météorologie, télécommunications, navigation, lanceurs et dans une moindre mesure applications militaires encore peu développées au niveau européen), l’Europe dispose de fait d’une base industrielle et technologique qui peut fournir l’ensemble des infrastructures et des services requis avec un niveau de performance et de qualité comparable aux meilleures productions mondiales. Exception notable : certaines activités spécifiques du vol habité (véhicules de transport, activités extravéhiculaires) auxquelles l’Europe a renoncé au début des années 90, sans que cela nuise à la qualité globale ou à l’image du spatial européen (impact mondial des programmes scientifiques Planck, Rosetta, ou des programmes d’application (Galileo, Copernicus). L’industrie européenne a par ailleurs démontré sa compétitivité dans le domaine strictement commercial. Les industriels sont très présents sur le marché mondial des satellites (observation et télécommunications) et des services de lancement et y rencontrent des succès auprès d’opérateurs privés internationaux. Malgré un volume d’activité et de financement public très inférieur à celui des autres puissances (Etats-Unis, Chine et Russie), lesquelles n’attribuent leurs financements publics qu’à leur industrie nationale (« Buy American Act » par exemple), la pratique du retour industriel ESA n’affecte donc ni l’autonomie européenne, ni la qualité des programmes ni la compétitivité. Tout indique au contraire que le cadre institutionnel européen « protecteur », principale source de financement du secteur spatial pour la R&T et les développements, et maître d’ouvrage de grands programmes a de fait contribué à la création et au maintien d’une industrie européenne de premier rang. La continuité des programmes et des financements de l’ESA a aussi permis une politique de spécialisation en Europe au-delà des « grands contributeurs » France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni : panneaux solaires aux Pays-Bas, calculateurs de bord et divergents pour la Suède, systèmes électriques et composants mécaniques pour la Belgique, horloges atomiques et coiffes pour la Suisse, opérations et mécanique spatiale en Espagne, etc., qui permet de satisfaire les besoins européens.
On peut aussi observer que progressivement l’application de la règle de retour s’est durcie. On est passé d’un coefficient de retour global garanti (calculé comme le rapport entre le pourcentage de l’ensemble des contrats reçus dans un Etat participant et le pourcentage des financements de ce pays à l’agence spatiale européenne) de 0,8 à plus de 0,95 ou parfois même de 1 pour certains programmes, assorti de mécanismes complexes de compensations. Equation devenue ingérable pour le responsable de programme avec en particulier l’accroissement du nombre d’Etats-membres, avec des niveaux de financement modestes et une industrie émergente, conduisant dans certains cas à un émiettement de l’organisation industrielle et une dilution des tâches de maîtrise d’œuvre. On ne connaît toutefois pas de programme institutionnel qui ait connu un échec technique en raison de l’application du retour géographique. Avec la montée en puissance du secteur privé initiée aux Etats-Unis (pas en Chine ou en Russie pour le moment), se pose tout de même la question de l’efficacité économique des industriels européens : l’industrie européenne propose-t-elle des objets de bonne qualité mais trop chers, ou plus chers que la concurrence ? Il faudrait pour être précis distinguer d’une part les programmes dits institutionnels pour lesquels les Etats européens mutualisent leurs compétences et leurs financements (les infrastructures que les Etats européens « achètent ») et d’autre part les programmes financés ou soutenus par les Etats mais destinés à la compétition sur un marché mondial (les programmes que l’Europe « vend » à des tiers) peu ou pas soumis à des considérations politiques.
Dans le premier cas (typiquement une mission scientifique, d'exploration, de météorologie), même s’il est admis que le coût d’un programme en coopération augmente en fonction du nombre de partenaires, chacun des partenaires ne paye que sa part, tout en bénéficiant de tous les résultats et services du programme, du prestige d’avoir participé à un programme d’envergure mondiale, et cela avec la certitude que leurs financements alimentent leur industrie nationale. Dans ce cas, la coopération s’impose, elle permet à tous les participants d’accéder à un programme dont l’ambition et le coût sont inaccessibles au niveau national. Pour le programme scientifique de l’Agence spatiale européenne, l’application de la règle du retour pour tous les Etats-membre mais selon la répartition des PIB (tous les Etats membres participent de façon obligatoire selon leur richesse nationale), est certainement l’une des clés de la création du programme et de sa pérennité et du soutien sans faille de tous les Etats-membres. Les missions sont sélectionnées par les scientifiques des différentes disciplines et réalisées par l’industrie européenne sous la responsabilité des équipes techniques de l’Agence spatiale européenne sans que l’on puisse attribuer un « drapeau » national aux satellites ou sondes développés ou à l’équipe en charge de la réalisation. Tout cela concourt à la fois à l’excellence et au caractère européen de ce programme salué mondialement. Pour le programme scientifique, comme pour les programmes facultatifs où chaque Etat détermine son niveau de financement, le retour financier vers l’industrie nationale est une motivation importante pour les Etats et l’une des clés du succès de la coopération via l’ESA et de son financement. Malgré la croissance du secteur privé, l’activité spatiale européenne reste largement dominée par la commande institutionnelle. Alors que les budgets communautaires censés ignorer les intérêts nationaux sont en croissance, cette commande publique reste majoritairement portée par l’ESA, agence de statut international, elle-même principalement financée par les budgets nationaux des Etats membres. Les Etats seraient-ils prêts à financer les programmes sans cette garantie de retour ? Toute réforme de la politique industrielle et du « retour » doit donc aussi sécuriser « l’aller » soit le flux contributif entrant, c’est à dire aujourd’hui le financement national des programmes qui maintient une industrie de taille modeste (quelques dizaines de milliers d’employés), détentrice du savoir-faire très spécialisé d’un secteur stratégique très dépendant de la commande publique.
Pour les systèmes, satellites ou services, qui se vendent sur un marché ouvert, c’est le client qui organise une compétition et sélectionne le meilleur concurrent selon un critère de « Best Value for Money ».
- Les satellites de télécommunications appartiennent majoritairement de cette catégorie et, dans une moindre mesure, les systèmes d’observation. Les maîtres d’œuvre qui répondent aux appels d’offre organisent leur structure industrielle pour bâtir la meilleure proposition. Les agences ne contribuent pas directement mais soutiennent l’industrie par le maintien des compétences communes mises en œuvre dans les grands programmes publics de développement et par des activités spécifiques de R&T dont les activités sont concertées avec l’industrie. Ainsi le programme technologique de télécommunications ARTES de l’ESA a pour objectif principal le soutien à la compétitivité de l’industrie.
- Pour les lanceurs, la situation est plus complexe, car il s’agit d’une activité que les Etats « achètent » pour garantir l’accès autonome à l’espace, clé de toute politique spatiale, et aussi une filière de services que l’on souhaite vendre sur le marché commercial à la fois pour l’activité induite, avec l’espoir d’en faire une filière industrielle rentable susceptible de contribuer aux coûts fixes de la filière (maintien des équipes et des usines, suivi de la qualité et de la fiabilité, base de lancement) grâce à une cadence de tirs plus élevée que celle, modeste, requise par les programmes institutionnels. Les Etats financent la R&T amont, l’essentiel des développements, les services de lancement dont ils sont clients - à un prix parfois supérieur à celui du marché (ESA, Défense) – et une part importante des coûts d’exploitation (dont ceux de la base de lancement). Tandis que le volume de l’activité industrielle de lancement est très largement conditionné par les ventes au secteur privé, le financement de la filière reste dépendant du secteur public en raison du poids des programmes de développement et des soutiens à l’exploitation.
Sur le marché commercial, après des années très favorables (où le concurrent principal était Proton depuis Baïkonour, les Américains étant peu présents après leurs déboires sur le Space Shuttle), l’opérateur européen se trouve aujourd’hui confronté au retour d’une concurrence américaine revigorée par de jeunes acteurs du secteur privé – largement soutenue par les clients institutionnels américains – qui démontre fiabilité, cadence de lancement et prix attractifs depuis des centres de lancement situés aux Etats-Unis à une demi-journée de vol des usines de satellites ! Le centre de lancement de Kourou qui était un atout face à Baïkonour ne l’est plus pour les opérateurs internationaux et les industriels américains. Avec la Floride, le Texas ou la Californie : « You fly domestic and you speak English. » En Europe, si l’accès autonome à l’espace reste une priorité absolue de toute politique spatiale indépendante, le faible nombre de lancements institutionnels annuels et la compétitivité accrue des lanceurs américains (soutenus par une commande publique sans commune mesure avec la commande publique européenne) pose de façon aiguë la question du soutien public à une exploitation commerciale. Cette question va en réalité bien au-delà de l’application ou non du « juste retour ».
Il est certain que l’application de la règle du retour géographique par Etat participant dans les programmes de l’ESA introduit des biais dans l’attribution des contrats., mais on ne peut attribuer à cette règle les difficultés ou les retards rencontrés par certains programmes. Le principal défaut de cette pratique liée à la conjoncture de naissance de l’ESA tient à la structure industrielle imposée par le système coopératif de l’ESA et de ses 22 Etats-membres qui tous souhaitent une place dans les grandes initiatives prestigieuses. Cela conduit à une abondance de contractants et à un éparpillement géographique de la production (usines, moyens d’essais, segment sol) pour satisfaire tous les participants avec parfois des niveaux de participation très faibles qui alourdissent la gestion par le maître d’œuvre, lui-même dilué et affaibli dans ses tâches de pilotage du programme. De plus, au-delà de la phase de développement, les Etats ne manifestent pas un grand enthousiasme à financer l’exploitation et en particulier la base de lancement pour laquelle aucun retour technologique intéressant ne peut être espéré. Bien que la plupart des sous-traitants soient sélectionnés après compétition, l’application de la règle du retour peut parfois conduire à la non-sélection du « mieux disant » au profit de l’industriel du pays qui n’a pas reçu son « retour ». La mise en œuvre du « juste retour » donne également lieu à des calculs savants et à des débats assez stériles (par exemple, retour par programme ou retour global ? retour financier ou retour technologique ? retour garanti à 80 % ou 95 % ?) qui constituent des obstacles au démarrage des programmes quand le consensus entre Etats participants est requis. Pour certains grands programmes facultatifs, la garantie du retour conduit les Etats à conditionner leur financement à la garantie a priori de voir leurs champions nationaux obtenir tel ou tel lot de travaux, ou à soutenir la création de consortiums artificiels et inefficaces rassemblant tous les maîtres d’œuvre potentiels qui se partagent les tâches et les financements en interdisant de fait toute compétition. Au final, l’application stricte du retour industriel a conduit dans certains programmes à des choix sous-optimaux en termes de compétitivité et pu handicaper les perspectives commerciales quand le produit développé se doit d’attirer des clients internationaux qui ne se soucient pas de la nationalité du fournisseur.
L’ESA a su mettre en œuvre, au début des années 2000 une approche qui peut réconcilier les avantages de l’efficacité industrielle et la garantie de retour aux Etats qui financent … et même un peu plus en cas de succès commercial. Il s’agit de transformer l’application du « juste retour » - qui contraint l’Exécutif à attribuer les contrats en fonction du niveau de contribution des Etats – et de mettre en œuvre un principe de « juste contribution » - qui consiste à inviter les Etats à financer les programmes en fonction de la répartition des contrats résultant de compétitions industrielles organisées par les maîtres d’œuvre et l’ESA. Cette méthode a été appliquée pour le programme de télécommunication Alphabus de développement d’une nouvelle plateforme de satellite géostationnaire de grande puissance destinée au marché mondial. Le maître d’œuvre (en l’occurrence les grands industriels français présents sur le marché des télécommunications et décidés à allier leurs forces sur le marché des « grandes plates-formes »), a proposé à l’ESA l’européanisation de son initiative sous réserve du respect des objectifs commerciaux. L’ESA qui n’a pas vocation à acheter de telles plates-formes de grande puissance pour ses besoins propres a proposé ce programme à ses Etats-membres, avec des règles adaptées à la nature du projet : la phase de définition (phase A et B) est menée par le maître d'œuvre dans une structure industrielle très resserrée avec une participation financière limitée aux Etats dont le maître d'œuvre est ressortissant. Pour Alphabus, le programme avait été engagé par le CNES sur fonds nationaux français et transféré à l’ESA, la France finançant cette phase de définition. Le plan d’approvisionnement pour les phases ultérieures (développement et production) est défini conjointement avec l’ESA qui organise les compétitions intra-européennes, La sélection des sous-traitants est arrêtée par le maître d'œuvre sur la base de la meilleure offre compétitive. L’ESA adresse alors aux Etats-membres le taux de contribution qui correspond au niveau de contrats obtenu par les industriels nationaux. L’adéquation entre financement national et activités industrielles est donc garanti, mais a posteriori. Le point clé pour obtenir l’adhésion des Etats tient au fait que le maître d’œuvre s’engage auprès de son fournisseur, au-delà du premier modèle financé par l’ESA, à inclure le sous-traitant retenu dans la production de la série qui sera proposée sur le marché commercial (où l’ESA n’intervient plus). En cas de succès commercial, l’activité de production financée par le client permet d’obtenir un retour d’activité supérieur à l’investissement initial consenti par l’Etat participant pour le développement. C’est un « sur-retour » qui est garanti en cas de succès. Cette approche a rencontré une certaine de la part de l’Exécutif de l’ESA qui voyait par là son pouvoir réduit dans la définition et le montage industriel du produit et qui craignait de perdre le soutien et le budget de ceux qui ne seront pas retenus. Certains Etats qui avaient l’habitude de peser pour satisfaire telle ou telle compagnie en fonction de telle ou telle priorité politique ont également contesté cette approche. Toutefois, la méthode a réussi et tous les sous-traitants (sauf un) ont été retenus sur la base de la meilleure offre. L’ESA a adressé aux Etats la « facture » correspondant aux compétitions gagnées par leur industrie, facture qui a été acceptée par tous.
Le succès de cette forme différente d’approvisionnement tient à plusieurs conditions essentielles :
- la crédibilité du maître d'œuvre et du produit qui offre une perspective de production en série,
- la confiance en l’Exécutif ESA qui doit s’assurer que les industriels des « petits pays » seront bien traités,
- le soutien du pays leader qui devra financer une part importante : les phases de définition,
- la part propre du maître d'œuvre, et les équipements gagnés par l’industrie nationale
- l’existence d’un programme « réservoir » flexible comme ARTES qui permet aux Etats d’adapter leurs contributions à l’intérieur d’un même cadre financier pluriannuel en fonction des compétitions gagnées sans perdre les fonds non utilisés qui peuvent être alloués à d’autres initiatives.
Ce programme de R&T ARTES essentiellement dédié au soutien à la compétitivité exige également un co-financement des industriels et reçoit un bon soutien de l’industrie et des Etats. Bien entendu la procédure ne fonctionne que si les sous-traitants retenus sont eux-mêmes compétitifs et s’il est possible d’organiser de vraies compétitions entre équipementiers, sans choix dictés par des considérations politiques des Etats ou du maître d'œuvre. Si l’éparpillement est un risque, le monopole en est un également. Il est fondamental que l’Europe spatiale dans la conjoncture actuelle dispose dans un certain nombre de secteurs de plusieurs sources en compétition susceptibles d’être retenues pour les programmes institutionnels ou commerciaux.
Une autre solution souvent citée viserait à adopter un financement européen communautaire sans contributions nationales identifiées. Pour la France, cette approche permettrait d’espérer un retour « naturel » conforme au poids de l’industrie française en Europe (environ 35 % à 40 %), soit près de deux fois le poids de l’Allemagne en ne finançant qu’au niveau du PNB (environ 17 %). Pour que cela fonctionne, il faut bien sûr que les autres pays dont les dépenses publiques et les capacités industrielles sont très inférieures à celles de la France adhèrent, au niveau européen, à l’ambition spatiale portée principalement par la France et acceptent de soutenir à leurs frais le maintien du leadership industriel français ! En l’absence d'une garantie de retour, le système de financement des programmes facultatifs de l'ESA où chaque pays détermine librement son niveau de participation aux programmes ne pourrait être maintenu, ce serait donc à une structure communautaire de prendre le relai.
Sans entrer en détail dans les questions d’organisation et de gouvernance européennes de type UE cette approche soulève plusieurs questions :
- Inscrire les activités spatiales dans un cadre programmatique UE, piloté par la Commission avec un budget spatial commun et des sélections des fournisseurs sur la base d’une compétition ouverte et non biaisée permettrait-il de s’affranchir des défauts du retour tout en conservant le niveau budgétaire de l’Europe ?
- Comment pallier la faiblesse de compétences techniques internes, ou d’autonomie, des différentes structures mises en place par la Commission (pour Galileo GJU, GSA, ou nouvelle agence communautaire EUSPA), sans dupliquer les compétences existantes et réduire le mille-feuille institutionnel décrié (agences nationales, ESA, agences de l’Union, Commission) ?
- Les Etats sont-ils prêts à intégrer les compétences propres de l’ESA sous leur autorité dans une structure pilotée par la Commission ?
- Est-il opportun que l’Europe s’ampute, comme elle l’a fait sur Galileo, des compétences industrielles de premier rang (et du financement) britanniques ?
Du côté de la Commission, le désir d’appuyer d’un poids croissant le secteur spatial alliant prestige politique, dimension stratégique, haute technologie et pilotage de l’industrie est louable ; mais moins évident quand il s’agit de contribuer à des activités moins nobles. Par exemple, le financement de Kourou « Port spatial de l’Europe » reste à ce jour purement intergouvernemental, inscrit parmi les activités obligatoires de l’ESA, et largement supporté par la France. La base est indispensable à l’Europe, mais son intérêt technologique est médiocre pour un coût important. Les Etats sont très réticents à financer une part même modeste des tâches d’exploitation sans synergies significatives avec l’activité européenne et largement consacrées à des dépenses de personnel local. L’attribution de contrats de maintenance à des entreprises européennes n’élimine pas frustrations et critiques localement et en Europe. La recherche du retour atteint ses limites. Dans le cadre de l’UE, autre question, le retour ne disparait pas aussi simplement : ainsi les programmes de R&T communautaires exigent le montage de consortium parfois artificiels où les critères politiques n’ont pas totalement disparu. L’expérience de Galileo, menée en principe sans contrainte de retour, a montré que la Commission elle-même a mis en place pour obtenir un accord politique des mesures contraires à la « compétition libre et non faussée ». Il a d’abord été décidé de confier le développement de l’infrastructure Galileo à une compagnie créée spécifiquement, en réalité une coopération entre concurrents plus intéressés par l’équilibre des financements et des pouvoirs au sein du consortium qu’à la bonne marche du programme (ESNIS ou Galileo Industries). Même après l’élimination de cette structure artificielle, la Commission a dû, sous la pression des Etats, structurer le projet en sous-ensembles taillés pour satisfaire les positions des champion nationaux : ainsi en raison de règles de non-cumul, le segment spatial ne pouvait échapper à l’Allemagne alors qu’une concurrence aurait été possible avec Britanniques, Italiens et Français. Le segment sol a lui aussi été réparti entre les pays avec une abondance d’infrastructures loin de l’optimum économique. La compétition pour définir l’opérateur de Galileo a fini par le choix d’un consortium fusionné, qui a disparu avec l’abandon du PPP. Si la Commission a pour rassurer les « petits » demandé aux maîtres d'œuvre de garantir un pourcentage de retour aux sous-traitants, elle n’a en fait jamais pu contrôler ce critère.
Alors que l’ESA, édicte dans sa Convention une règle générale de préférence européenne, la Commission n’a pas vraiment de politique générale de ce type pour ses achats. Elle avait même souhaité ouvrir, pour Galileo, certaines compétitions à des fournisseurs hors UE (et même hors Europe), pour des éléments techniques clés. Dès lors, la question de l’achat des services de lancement « standards » pour des programmes « civils » auprès d’opérateurs exclusivement européens se pose. Contrairement aux agences fédérales américaines, la Commission ne semble pas prête à acheter des lancements à un prix correspondant au coût « réel » c’est à dire supérieur au prix de marché afin de soutenir la filière d’indépendance. Les Etats, habitués à s’approvisionner pour leurs besoins de défense aux Etats-Unis, verraient-ils vraiment des objections à acheter des lancements non-européens moins chers qu’Ariane ou Vega, surtout si ces lanceurs européens restent pour certains un lanceur « français » ou un lanceur « italien ».
En conclusion, dans un paysage dominé dans les faits par la commande publique financée par les budgets nationaux, l’Europe a forgé une capacité industrielle autonome et de qualité capable de développer, produire opérer toutes les infrastructures spatiales – il s’agit là au moins d’un point d’accord entre agences et industriels.
L’application du « juste retour » a contribué jusqu’à maintenant à l’émergence d’une structure industrielle y compris dans les « petits pays », source de fierté nationale et de financement. En revanche, cela a conduit avec l’accroissement du nombre de pays membres, à un émiettement des participations aux programmes nuisible au pilotage industriel, à des choix ne favorisant pas la compétitivité et également à des duplications d’infrastructures (y compris dans les grands pays qui ne sont pas prêts à renoncer à certaines installations).
Des aménagements du système actuel semblent possibles :
- pour éviter le trop grand nombre de participants par programme, en appliquant plus rigoureusement la règle de la participation minimale pour les programmes ESA
- pour éviter les duplications excessives, en soutenant une politique de spécialisation permettant l’émergence de quelques champions européens,
- pour favoriser la compétitivité de l’industrie, en favorisant autant que possible les compétitions intra-européennes et pour les programmes destinés à un marché ouvert privé en appliquant le principe de la « juste contribution » pour les développements financés par le secteur public,
- en assouplissement l’application comptable de la règle (retour global, retour à un taux garanti de 80 %),
- en imposant autant que possible pour les programmes destinés au marché commercial ouvert des règles de co-financement, garantie en quelque sorte d’engagement réel de l’industrie et aussi marque de confiance dans un retour sur investissement hors commandes publiques.
Pour aller plus loin et s’affranchir des contraintes du retour industriel, l’Europe pourrait privilégier l’achat de services offerts par l’industrie européenne et développés sur fonds privés. Le domaine des lanceurs semble adapté à cette approche (existence d’un marché privé et public) pour des services largement standardisés de nos jours. L’industrie européenne des lanceurs souhaite s’affranchir des contraintes du retour, elle ne s’en cache pas et cherche une forme de dialogue avec les agences gouvernementales nationales et européennes. Mais est-elle en mesure de prendre pleinement en charge les risques inhérents et faire l’impasse sur les financements publics des développements et cela tout en revendiquant un renforcement de nouveaux programmes publics captifs (le vol habité) ?
On en revient par conséquent à la question initiale du financement des activités spatiales dans une Europe qui ne va pas cesser de s’élargir tandis que les nations sont de plus en plus jalouses de leur intérêt national industriel, avec des contraintes financières/budgétaires corrélées au retour industriel, le tout dans un cadre encore largement national (Chine, US, Russie).
Dans le cas particulier de l’Europe – qui n’est ni une assemblée lâche d’Etats nationaux ni une fédération armée pour faire face à toutes sortes de menaces régaliennes, scientifiques et commerciales – le défi appelle à des évolutions vertueuses. Si remplacer le financement intergouvernemental par un financement communautaire « sans couleurs nationales » est aujourd’hui selon certains supposé nous affranchir des contraintes liées au retour, cela suppose à budgets publics constants une augmentation substantielle (facteur 3 ou 4) des budgets publics communautaires alloués au spatial, et donc d’une part une acceptation politique des Etats de l’Union qui perdraient la garantie de retour et d’autre part la mise en place d’une réelle expertise technique et de capacité d’achat de systèmes spatiaux au sein des institutions de l’UE. La réflexion actuelle des acteurs étatiques, industriels et académiques de la filière spatiale sur les mérites et limites des principes inscrits dans la Convention de l’ESA au sujet de la politique industrielle, dans un domaine désormais en bonne partie européanisé, n’est pas sans mérite : ne serait-ce que du fait qu’à l’évidence les recettes du passé ne sont plus valables dans un environnement des activités spatiales institutionnelles et commerciales en évolution rapide à l’échelle internationale et avec l’émergence d’acteurs nouveaux aux côtés des agences spatiales. Le retour industriel géographique ne pose à ce jour, faut-il le rappeler, de problème majeur ni pour la science, ni pour l’exploration, ni pour la météorologie, ni pour l’observation de la Terre, ni pour les télécommunications. Il peut conduire à des désoptimisations économiques, en particulier pour les produits et services développés dans le cadre ESA et appelés à se développer dans un cadre commercial. Des mesures d’assouplissement ou une évolution vers une « juste contribution » semblent pouvoir atténuer les défauts les plus criants. Enfin la règle du retour est basée avant tout sur le principe d’une préférence européenne financée librement par les Etats : ses qualités (sécuriser « l’aller » c’est à dire le financement) comme ses défauts (ici évoqués) en sont la conséquence. Dès lors, la contradiction avec les règles européennes de compétition et de soutien public doit être tranchée par les Etats, sans nuire aux succès et au maintien du secteur spatial européen unanimement reconnu comme un succès de la construction européenne.
Commentaires